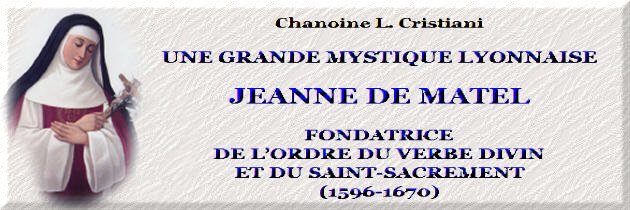CHAPITRE II
Fondation de l'Ordre du Verbe Incarné
De bonne heure, Jeanne de Matel se sentit appelée à fonder un Ordre à la gloire de la Très Sainte Trinité, où elle voyait tous les Ordres religieux prendre naissance, comme en leur source éternelle. Dès 1619, cette pensée apparaît dans sa vie. Mais ce ne fut qu'au début de 1625, que ces inspirations se firent à la fois plus précises et plus pressantes.
«Le 15 janvier 1625, écrit-elle, étant à la messe que le R. P. Cotton disait dans la petite chapelle du collège de Roanne, vous élevâtes mon esprit en une sublime suspension. Pendant icelle, Vous m'apparûtes avec un manteau de pourpre, usé et quasi décoloré, me figurant celui qu'on vous donna par dérision, avec la couronne d'épines et un roseau pour sceptre, vous disant avec moquerie : Ave, Rex Judoeorum! Vous fîtes de mon âme Votre tabernacle et de mon coeur Votre trône, me faisant entendre que Vous vouliez que les filles de Votre Ordre portassent un manteau rouge. Pardonnez, Amour, à la réponse que, par respect humain, je vous fis alors, en vous disant :
« – Seigneur, on rira de moi quand je proposerai ce manteau rouge.
« – Ma fille, me dites-vous, ne l'ai-je pas reçu par moquerie? Mes épouses doivent aimer mes mépris et mes souffrances pour se mieux conformer à moi.
«Quelques mois après, Vous m'apparûtes revêtu d'une robe blanche, me disant :
« – C'est Moi qui suis l'Époux candidus ac rubicundus...C'est de ce blanc d'innocence et de ce rouge de charité que je veux revêtir les filles de mon Ordre; ce sont mes couleurs, mes livrées qu'elles doivent porter.»
C'était déjà très net. Mais Jeanne fut bien étonnée, quand une pieuse fille de sa connaissance, très élevée en dévotion, mais sachant à peine lire et encore moins écrire, nommée Catherine Fleurin, vint lui dire que Dieu lui avait fait connaître que Jeanne devait réaliser au plus tôt ce projet dont elle n'avait parlé à personne. Elle ne se redit cependant pas tout de suite, car, explique-t-elle, «je ne suis pas facile à croire aux révélations».
Catherine insista au nom de Dieu. Jeanne touchée de cette assurance se mit en prière. De vives lumières lui furent accordées. Alors elle ne résista plus et s'écria :
«Amour, je vous promets que je sortirai de chez mon père, aussitôt que j'aurai le consentement du R.P. Jacquinot, à qui Votre Majesté donnera la volonté de me permettre cette sortie.»
Elle vit en effet le révérend Père, de passage à Roanne, le 22 juin 1625. Il y avait alors, en France, un préjugé défavorable à la création de nouveaux Ordre. On estimait communément qu'il fallait d'abord réformer les anciens, avant d'en inventer d'autres. Le père hésitait. Jeanne attendait son verdict avec confiance. A la fin, convaincu par ses explications, il lui dit :
«Commencez, ma fille, quand vous pourrez!»
La décision était prise. Il s'agissait de passer à l'exécution. On a vu que Jeanne était déjà fixée sur les «couleurs» du vêtement de l'Ordre futur : le blanc et le rouge. En ce même 22 juin 1625, au cours d'une fervente oraison, elle vit une couronne d'épines, au dedans de laquelle était écrit le nom de Jésus ; au dessous, un Coeur avec trois clous et cette inscription : amor meus. Puis Dieu lui dit :
«Ma fille, mon nom est « une huile répandue». Plusieurs filles seront attirées à cet Ordre par la douceur de celui-ci. Fais mettre sur le scapulaire ce que tu as vu en cette vision, a fin que je repose sur la poitrine de mes fidèles épouses.»
A cette date, pourtant, Jeanne n'était pas encore fixée sur le nom à donner à l'Ordre nouveau. Il semble qu'elle se soit arrêtée alors au titre suivant : Les Filles ou les Religieuses de l'Agneau-Jésus. C'était en effet l'une de ses plus anciennes pensées qu'elle devait être au nombre des «vierges qui suivent l'Agneau partout où il va ».
Nous sommes informés des intentions de la jeune fondatrice, par le texte d'un projet de Constitutions, qui ne furent pas appliquées telles quelles, et qui date de 1624. On doit regarder comme probable qu'en 1625, elle n'avait pas changé substantiellement d'avis. Elle assignait à son Institut un rôle d'imploration pour la paix de l'Église. Elle avait donc des vues très hautes et très vastes :
«Des prières pour la paix de l'Église catholique, l'union des prélats d'icelle et l'union des princes chrétiens, priant l'Agneau divin de les toujours éclairer de sa lumière et de s'offrir continuellement à son Père, pour l'avancement et conservation de l'Église et des royaumes et provinces chrétiennes. De plus cet Institut doit aviser à prier pour l'extirpation des hérésies ; qu'il plaise à cet Agneau de redresser, par sa verge veillante, ses ouailles et les ramener au parc du Souverain Pasteur, sous l'obéissance de son Vicaire, notre Saint-Père le Pape. En dernier lieu, il est très raisonnable que dans l'Église soit dressée un Institut qui adore et honore le divin Agneau, pour contrecarrer les abominables offrandes, mais horribles, que font les vilains sorciers au Bouc puant, le Prince des ténèbres».
Rappelons-nous la date de ce document : 1624. C'est l'année où Richelieu arrive au pouvoir. La France est menacée à la fois de la guerre civile, par la rébellion des huguenots, et de la guerre étrangère, par la rivalité entre la maison de France et la maison d'Espagne. L'Allemagne est déchirée et ravagée par l'horrible Guerre de Trente ans, qui dure depuis 1618. Les campagnes sont livrées aux plus affreuses superstitions. Avec une étonnante clairvoyance, Jeanne de Matel considérait donc comme les maux les plus graves de la chrétienté, les trois plaies suivantes : la désunion des princes et des prélats, -le pullulement des hérésies,- l'expansion de la sorcellerie dans le bas peuple. Et c'était contre ces trois fléaux qu'elle entreprenait, elle, humble jeune fille, de lutter par l'ardeur de son amour pour le divin Agneau.
Et ce fut le 2 juillet 1625, jour de la fête de la Visitation, qu'elle quitta la demeure paternelle, pour commencer, avec deux compagnes, l'Ordre qu'elle voulait fonder.
Comme toutes les grandes choses, l'Institut fut marqué, en ses débuts, par la croix et l'épreuve. Les premiers mois de la vie commune furent pour Jeanne des mois de crucifixion, de délaissement, de chagrin intime et de trouble. Mais au bout de trois mois, son Jésus fit luire de nouveau sur son coeur le beau soleil de l'amour et de la joie. La petite communauté, établie d'abord à Roanne, végétait cependant. Le confesseur de Jeanne lui conseilla d'aller à Lyon, pour solliciter de l'archevêque la permission d'établir son Ordre en cette ville. Elle obéit et arriva au jour même où l'archevêque, Mgr Miron, successeur de Mgr de Marquemont, prenait possession de son siège, la veille ou l'avant-veille de l'Ascension de 1627. On lui avait fait craindre un mauvais accueil de la part du prélat. Mais après un long et minutieux examen, l'archevêque finit par lui dire :
«Ma fille, si ce dessein n'était que de vous, comme je suis l'évêque des évêques contraire aux Instituts nouveaux, je vous renverrais ; mais parce qu'il est de Dieu, j'approuve votre Congrégation, pour Roanne, puisque vous me priez de cela. Faites dresser une requête aux RR. PP. Milieu et Maillant et je la signerai.»
Sur ces paroles si encourageantes, les conseillers de Jeanne la poussèrent à demander l'autorisation plutôt pour Lyon. Elle le fit et l'obtint sans peine, chercha une maison, en trouva une «sur la montagne du Gourguillon» et en fit l'acquisition. Tout allait pour le mieux. Nul doute que si Mgr Miron avait vécu, elle aurait réussi à ériger canoniquement son monastère de Lyon, à cette époque. Mais il mourut, jeune encore, au début d'août 1628. Tout resta en suspens.
Notre intention ne saurait être, en cette courte biographie, de suivre Jeanne de Matel, pas à pas, en tous ses déplacements. Ce qui nous intéresse ici, c'est son esprit, ce sont les faveurs divines qui en provoquent l'essor, ce sont les jugements des contemporains sur elle, dans la mesure où ils peuvent guider les nôtres.
Sur l'avis de ses conseillers, Jeanne avait quitté sa communauté de Lyon pour se rendre à Paris où la mandait le R.P. Jacquinot. En cours de route, elle demeura dix-sept jours à Orléans. Sa réputation était déjà si grande qu'on se disputait l'honneur de la recevoir ses lumières. Le recteur du collège des jésuites d'Orléans lui rendit témoignage qu'elle était, selon sa pensée, «la créature que Dieu favorisait le plus, sur la terre». Il avait donc, dans son maintien, dans son langage, dans toute sa personne, des signes qui prévenaient en sa faveur et donnaient l'impression de la plus haute vertu. Elle arriva à Paris, le 29 novembre 1628. Elle devait y rester quatre ans, jour pour jour. Comme on était à la veille de la fête de saint André, elle se rendit dans l'église décidée à ce grand saint. Là ses yeux fondirent en larmes et, prévoyant les grandes contradictions qui l'attendaient, elle pria en ces termes :
«Seigneur, je vous adore et vous remercie de ce que, selon vos promesses, vous m'avez amenée à Paris. Je sais bien que j'y souffrirai et que j'y trouverai des croix. Le jour que je sortis de Lyon était le jour de l'Exaltation de la Sainte Croix ; je ne refuse pas toutes celles que vous m'avez destinées. J'appréhende celles que mon père, qui est dans cette ville et en Cour, me fera souffrir.
Donnez-moi, s'il vous plaît, du courage ou disposez son esprit à vos volontés, puisqu'il n'est en colère contre moi que pour avoir quitté sa maison, selon vos ordres.»
La dernière partie de cette prière fut exaucée. Elle eut une entrevue avec son père, qui ne la traita pas aussi durement que ses lettres avaient pu le faire craindre. Elle avait perdu sa mère, en 1626 et aurait pu compter sur l'assistance de son père pour ses projets de fondation. Elle n'osa cependant rien lui demander et vécut, en quelque sorte, de la charité des uns et des autres. Dieu lui donna heureusement une bienfaitrice en Mme. de la Rocheguyon, qui loua une maison pour elle, le jeudi-saint de 1629.
Le lendemain, vendredi-saint, elle vit, à son réveil, un pressoir qu'il lui fallait tourner toute seule. Elle comprit que l'épreuve allait fondre sur elle. De fait, les grandes oppositions commencèrent. La protectrice des ursulines de Paris, Mme. de Sainte-Beuve, prit ombrage des projets de congrégation que l'on prêtait à Jeanne. Elle estima que ces projets pouvaient nuire au développement de l'Institut des ursulines. Elle fit valoir que les religieuses de la Mère de Matel ne seraient qu'une sorte de «jésuitesses», dont saint Ignace de Loyola avait toujours rejeté le principe. Plusieurs Pères de la Compagnie écrivirent au Général leur donna raison et interdit aux Pères de Paris de s'occuper du nouvel Institut. Ses lettres conseillaient même d'abandonner entièrement à elle-même «cette fille étrangère».
Ce fut pour Jeanne un coup terrible. Elle avait été constamment, jusque-là, guidée, approuvée, encouragée, aidée par les Pères de la Compagnie. Et maintenant, elle se voyait délaissée par eux. Elle comprit ce qu'était ce pressoir qu'il lui fallait «tourner toute seule».
Mais elle ne perdit pas courage. S'humiliant devant Dieu, en ses oraisons plus ferventes que jamais, elle s'offrait aux humiliations, demandant au Seigneur de la confondre, si elle avait présumé, sans le savoir, d'instituer un Ordre qui ne fût pas selon sa sainte volonté. Son coeur était oppressé comme d'une lourde pierre et de ses yeux coulaient de grosses larmes. Soudain, les paroles de Gamaliel lui revinrent en mémoire : «Si ce dessin vient des hommes, il sera dissous ; mais s'il vient de Dieu, vous ne pourrez le détruire.» Et elle entendit la voix de Dieu qui disait :
«Ma fille, cette entreprise n'est ni de toi ni des hommes. Elle est de moi, qui permets que tu sois délaissée, a fin que je fasse mon œuvre, moi qui fais des merveilles, tout seul...»
De fait, Jeanne, puissamment fortifiée au dedans par la grâce divine, trouva de nouveaux appuis. Le Général des Jésuites, mieux informé, adoucit sa défense. Bref, elle put faire, en Cour de Rome, les premières démarches pour la reconnaissance de son Ordre C'est alors qu'elle fut amenée à établir le nom que cet Ordre devait porter. Nous avons dit qu'elle avait songé, en 1624, à un Ordre de l'Agneau-Jésus. Dans la suite, il semble qu'elle ait songé à un Ordre des Filles du Saint-Sacrement. Mais ce nom était réclamé pour Port-Royal, par l'évêque de Langres, l'illustre Sébastien Zamet. Jeanne alors, comme toujours, s'adressa à son divin Epoux :
«Seigneur, dit-elle, quel nom voulez-vous donner à votre Institut, qui comprenne tout ce que vous m'avez promis?
« – Ma fille, je suis la Vérité infaillible, je te tiendrai toutes mes promesses : le nom que tu demandes est Verbe Incarné, ce nom comprenant avec éminence et par excellence tout ce qui est de moi, en tant que Verbe Incarné. En ce nom tu auras tout... Je t'assure, ma fille, que ce nom sera donné à mon Ordre sans contradiction. C'est moi, ma très chère, qui te donne ce Nom auguste et glorieux. J'ai été et je suis, dès l'éternité, le Verbe Incréé, je serai indéfiniment le Verbe Incarné.»
La Bulle demandée à Rome fut en effet obtenue. Mais avant d'avoir pu la faire exécuter à Paris, Jeanne avait dû revenir à Lyon, pour reprendre en main l'établissement qu'elle y avait fondé cinq ans auparavant.
A Lyon, où elle arriva, le II décembre 1632, de nouvelles contradictions l'attendaient. Mais elle reçut aussi de nouvelles preuves de la protection d'en-haut. Elle remit de l'ordre dans sa maison, qui avait beaucoup souffert de son éloignement. C'était toujours le recteur du collège des jésuites qui lui servait de conseiller, en toutes choses. Ce Père, qui était le P. Poiré, se déchargea cependant de la direction de Jeanne sur un des ses Pères, dont il connaissait la haute valeur, le R.P. Gibalin. Celui-ci n'avait pourtant, au début, que des préventions contre l'Ordre du Verbe Incarné et sa fondatrice. Mais quand il eut constaté sa patience, sa douleur, sa soumission, la hauteur de ses pensées, il fut complètement retourné en sa faveur et devint son plus ferme et plus constant soutien. Il devait écrire le 20 février 1634 :
«Je me contenterai... d'exprimer en peu de mots ce que d'expérience me fait connaître et qui est d'autant plus éloigné du soupçon de complaisance que, pendant cinq années, j'ai obstinément refusé de donner créance au récit des choses que j'ai ouï dire de cette vertueuse fille. Je reconnais donc qu'entre les grâces et les faveurs que la nature lui avait faites, elle reçu en partage un esprit vif et pénétrant, un jugement solide, une mémoire très heureuse, un courage inébranlable, une inclination portée à la vertu, une âme née pour les grandes choses...»
Mais le P. Gibalin ne se bornait pas à cet éloge des qualités naturelles de Jeanne. Il reconnaissait qu'il avait mis à l'épreuve ses dons surnaturels, et qu'elle était sortie victorieuse de cet examen prolongé de sa part. Peu après son retour à Lyon, Jeanne avait en effet reçu de son nouveau directeur, l'ordre de mettre par écrit ce que nous pourrions appeler ses «élévations spirituelles».
De fait, on possède aux Archives du monastère du Verbe-Incarné de Lyon un recueil, dans lequel, à partir du 1er. avril 1633, se trouvent réunies des pièces de longueur inégale, format une sorte de Journal Spirituel. D'après ses propres indications, elle souffrait tellement des yeux qu'elle ne pouvait presque plus écrire de façon lisible. Elle rencontra heureusement, chez ses filles, un secours providentiel. L'une d'entre elles, Soeur Françoise Gravier, qui avait une très belle écriture, devint sa secrétaire et ne la quitta presque plus, durant trente-sept ans qu'elle vécut encore. Sœur Gravier apprit très vite à déchiffrer les brouillons de la Mère et c'était elle qui les mettait au net. C'est grâce à elle que nous possédons un si grand nombre d'écrits de la fondatrice.
Un chiffre nous aidera à fixer les esprits. Du 1er. avril 1633 au 17 février 1642, date à laquelle le Journal Spirituel fut interrompu, pour la raison que nous aurons à dire, il ne se trouve pas moins de 346 élévations ou morceaux distincts, dont le sujet se rattache d'ordinaire, de la façon la plus étroite, à la liturgie quotidienne de l'Église. Le P. Gibalin avait donc des éléments d'appréciation de plus en plus nombreux. Un exemple va faire voir le genre d'écrits qui furent soumis par Jeanne à son examen et à celui de ses confrères.
«Le mardi de Pâques (1er. avril 1633), m'étant présenté à la sainte communion, sans beaucoup de préparation, mon indisposition et infirmité corporelle ne me l'ayant pas permis et m'ayant contrainte de faire la sainte communion avant d'ouïr la messe, ayant reçu mon divin Saveur, je lui dis que, comme il était entré ce jour-là, dans la Cénacle, les portes closes, pour visiter ses apôtres, qu'il pouvait aussi entrer dans mon coeur et dans mon âme, visitant toutes mes puissances, quoique je ne visse pas en mon âme les dispositions et préparations nécessaires.»
On remarquera tout de suite, dans ce préambule, le caractère liturgique de la piété de Jeanne. Nous avons noté déjà que sa «spiritualité» était essentiellement biblique et théologique. A ces deux premiers traits, nous en joignons un troisième : cette «spiritualité» était également liturgique. Jeanne vit intensément avec l'Église. Chaque fête lui apporte une joie nouvelle et lui fournit un aliment mystique. Il est rare que, dans ses méditations, on ne trouve pas la trace explicite des textes liturgiques du jour. C'est dans l'épître ou dans l'évangile, ou dans quelque autre partie de l'office quotidien qu'elle cherche sa réfection spirituelle.
Mais presque aussitôt son âme prend son vol. Une vision lui apparaît. Une «locution» retentit à ses oreilles. Elle ne comprend pas toujours tout de suite. Elle demande une explication à son Sauveur et elle la reçoit ordinairement sans retard. Évidemment, il y a chez elle une vivacité, une richesse d'imagination, qui sert de point d'insertion à la grâce divine. Mais de même que le spectacle de la nature laisse certaines personnes frustes presque insensibles, tandis que d'autres s'exaltent sans s'élever au-dessus de ce que leurs regards de chair aperçoivent, et que d'autres enfin montent d'un trait jusqu'au Créateur et ne se servent des beautés visibles que pour se jeter dans la splendeur de la Beauté invisible, de même les jeux variés de l'imagination peuvent être, chez les uns, à peu près insignifiants, chez d'autres ils deviennent un miroitement et revêtent une luxuriance qui les flatte mais qu'ils ne dépassent pas, tandis que chez Jeanne, comme chez tous les grands mystiques, ils servent comme de tremplin adoré et aimé.
C'est ce que l'on va voir dans la suite du morceau ici analysé :
«Lors me parut, écrit-elle, une fleur de couleur violette, d'une incomparable beauté et surtout d'une admirable délicatesse pour l'attouchement. Il ne s'en voit point de pareilles en nos jardins ni en nos parterres. Cette fleur étant disparue, je demandai à mon divin Époux florissant, qu'il n'était pas seulement une fleur, mais un jardin et un parterre tout entier, au dire de son Épouse, au Cantique des Cantiques ; «Genae illius sicut areolae aromatum, consitae a pigmentariis» (Ct, V, 13)... que cette fleur m'avait été représentée de couleur céleste plutôt que le blanche, parce que cette peinture faisait de plus fortes impressions que la blanche qui, dispersant la vue ne la frappe pas si fort, elle s'évanouit et se perd plus tôt, et parce que le bleu ou violet marquait la mortification, -aussi l'Église, pendant l'Avent et la Carême, alors qu'elle est dans les gémissements et dans le pénitences pour l'attente de la naissance ou pour la mort de son Époux, s'habillait-elle ou se revêt-elle de cette couleur. Par l'innocente délicatesse qu'il se percevait, en touchant cette même fleur, il me marquait les délices que ressentent les âmes jusque-là mortifiées, en l'attouchement de son humanité glorieuse et de ses plaies...»
Et la méditation se poursuit longuement encore, en montant de plus en plus vers les sommets de la pensée théologique. Les textes bibliques viennent sans effort sous la plume de Jeanne, qui les cite toujours en latin, sans les traduire, et toujours avec à propos, bien qu'elle n'eût jamais étudié le latin. De même, les expression techniques de la théologie scolastique abondent chez elle.
Voici par exemple la fin de la même élévation :
«J'entendis qu'ainsi se doivent entendre les paroles de saint Jean : «Quod perspeximus et manus nostrae contrectaverunt de Verbo vitae» (I Jn, I, 1). Le Verbe, qui est la Vie, s'est rendu palpable, traitable et maniable par l'humanité qu'il s'est unie en unité de personne. Cette attouchement n'est pas d'une chair morte, ou vivante d'une vie seulement animale, mais d'une vie divine. Et, comme on dit que nous touchons la personne tout entière, encore que nous touchions que sa chair et non pas son âme, et que nous voyons le soleil, quoique, souventes fois, nous ne voyions qu'un air illuminé ou une nuée rayonnante, ainsi nous touchons le Verbe de Vie, qui fait un composé admirable avec cette divine Chair, qui subsiste divinement en Lui et par Lui.»
Comment ne pas voir, dans ce passage, que les termes : composé, subsister, unité de personne, sont des termes spécifiques, dont la piété courante ne sert presque jamais, dans la crainte bien légitime de ne pas savoir en user avec exactitude. Jeanne au contraire les affectionne. On les trouve à chaque page, sous sa plume. Elle traite des processions divines, de la communication des idiomes, de la circumincession de trois Personnes divines, de l'union en l'hypostase, et d'autres mystères estimés inaccessibles à quiconque n'a pas fait des études théologiques poussées très loin, avec la sûreté, la précision et, si l'on peut dire, la familiarité d'un professionnel. Justement, ses contemporains ont été très frappés de cette particularité des écrits de Jeanne. Et nous allons voir comment son archevêque, jugeant la chose trop extraordinaire pour être admise aisément, résolut de la mettre à l'épreuve.
![]()