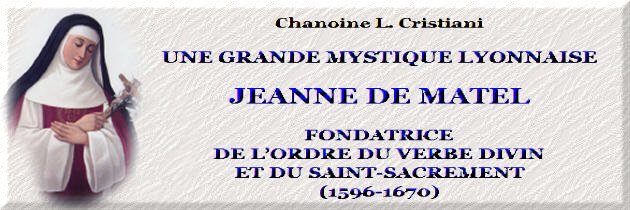CHAPITRE V
Raisons qui
peuvent faire désirer
la glorification de la Servante de Dieu
Jeanne de Matel
Les chrétiens de notre temps sont, à juste titre, avides de «spiritualité». Ce que nous aimons dans les grandes âmes que l'Église propose à notre admiration et à notre culte, c'est leur ardeur à s'élever vers Dieu, et ce que nous recherchons dans leurs écrits et leurs exemples, ce sont les moyens qu'ils ont employés pour cela. «Dieu est ESPRIT, a dit Jésus, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité.» (S. Jean, IV, 24.) La «spiritualité» n'est rien d'autre que cela.
On a déjà vu, dans les pages qui précèdent, quels étaient les traits principaux de la spiritualité de Jeanne de Matel. Sa dévotion était éminemment liturgique, théologique et biblique. Or, ce sont justement ces trois caractères qui nous paraissent conférer à sa cause une importance et une actualité évidentes.
Jeanne de Matel semble avoir été suscitée pour prouver que le culte des Saintes Ecritures, qui fut, chez elle, si vivant, si élevé, si fort, s'allie sans aucune gêne à goût très prononcé pour les plus hautes spéculations théologiques, d'une part, et les plus humbles pratiques de la piété liturgique, d'autre part.
En effet, c'est régulièrement dans l'office liturgique du jour, dans la fête du saint inscrit au calendrier de l'Église, dans la célébration du mystère que le calendrier indique, en un mot dans la vie quotidienne de l'Église, que Jeanne prend le thème de son oraison. Mais presque aussitôt, c'est par un texte biblique, se référant à l'office liturgique du jour et, le plus souvent, suggéré par cet office, que Dieu parle à son cœur. Comme elle aimait à le dire, l'Écriture est «son chiffre». C'est pour elle le livre divin dans toute la force du terme. Elle y trouve abondamment sa nourriture. Un texte éclate dans son esprit, comme elle dit, en manière «de coruscation». C'est comme un éclair qui fend la nue. Et de même qu'après l'éclair, on entend longtemps se prolonger les grondements du tonnerre, dans la pensée de Jeanne, coruscation biblique se prolonge en réflexions presque sans fin. Elle ne nous cache pas qu'on la trouvait prolixe. Elle n'avait jamais fini de tirer les déductions du texte qui avait soudain lui à ses yeux. Elle était littéralement inépuisable. Chaque mot de l'Écriture lui était une source délicieuse dont elle buvait avidement l'eau vivifiante. En cache parole, elle savait qu'elle pouvait et devait trouver la parole même du Verbe éternel.
On peut donc dire que si, par ailleurs, l'Église trouvait en elle les conditions nécessaires à la béatification et à la canonisation, rien ne serait plus instructif pour nous que de mettre en évidence, par son exemple, la puissance d'édification, d'illumination, de perfectionnement spirituel qui se trouve, par les Saintes Écritures, mise à la disposition du fidèle catholique, sous le contrôle supérieur de la sainte Église, dépositaire de la Parole sacrée. On a si souvent avancé, sans preuve, que l'Église catholique se défiait de la lecture de la Bible, alors que le protestantisme en faisait la règle de sa vie religieuse, que le culte de l'Écriture, chez une simple femme du monde, comme Jeanne de Matel, fournit une excellente réplique à cette accusation dénuée de tout fondement.
Allons-nous attribuer à Jeanne de Matel un rôle doctrinal au sein de l'Église? Cela a été dit parfois, en son temps comme au nôtre. Nous avons vu les discussions qui se produisaient sur son cas et les contradictions dont elle était l'objet. Mais il est clair que l'Esprit de parti et de dénigrement a obscurci le problème qui est en réalité fort simple. Jeanne a toujours soumis très humblement ce que l'on appelait ses «révélations» au jugement de ses directeurs et de l'Église en général. En disant ici que sa «spiritualité» était non seulement liturgique, mais théologique et biblique, nous sommes bien loin de d'insinuer qu'il faut aller chercher dans ses écrits des leçons de théologie ou d'exégèse. Ses interprétations de l'Écriture, toujours pieuses et souvent intéressantes, ne sont jamais scientifiques, en ce sens qu'elles ne reposent jamais sur une connaissance sérieuse de la critique du texte ni des principes selon lesquels on doit l'entendre. De même, elle n'a rien appris à la théologie. Il était déjà bien beau que, sans études préalables, elle pût se servir couramment du vocabulaire spécial de la théologie et parler avec précision et exactitude des grands dogmes chrétiens. Quelle fut donc la mission de Jeanne? Nous répondons : celle de tous les saints sans exception : aimer et apprendre aux autres à le faire.
C'est elle-même qui nous le dit, dans le passage suivant, que nous considérons comme décisif pour la bien juger et l'apprécier à sa valeur : le morceau est daté du 22 mars 1637, elle a alors 41 ans et elle est, peut-on dire, à l'apogée de sa carrière. Dès le titre, nous sommes instruits du contenu de la pièce :
«Que la divine bonté se plaisant à m'instruire... me commanda d'annoncer l'évangile d'amour.»
«Je demandai, dit-elle, à ce mien divin Époux qu'il m'expliquât comme j'étais cet évangile d'amour. Il me répondit que l'Évangile de puissance avait été donné aux apôtres, par les opérations miraculeuses qu'ils ont faites, lesquelles sont des productions d'une puissance extraordinaire, par laquelle ils ont converti le monde...»
«Il me dit que l'Évangile de sapience appartenait aux docteurs, qu'il a faits les maîtres du monde, pour enseigner la doctrine et pour expliquer sa parole.»
«Que, pour moi, l'Évangile d'amour m'avait été réservé, que je le recevais en recevant le Verbe qui est fait sur moi, ainsi qu'il est dit en saint Luc : -La parole du Seigneur fut faite sur Jean- ; que je devais toujours et partout annoncer l'Évangile d'amour et de bonté, laquelle il se plaisait de m'enseigner et de me faire voir ses excellences divines...»
Que pouvons-nous désirer de plus claire ? Jeanne ne s'attribue aucunement ni l'Évangile d'autorité doctrinale ou de puissance par les miracles, ni l'Évangile de haute spéculation par la science théologique, mais seulement l'Évangile d'amour qui appartient à tous les grands amis de Jésus Christ. Or, cet Évangile d'amour était particulièrement nécessaire à la veille du temps où le jansénisme allait s'acharner à ne se montrer en Dieu que le visage de la justice et de la rigueur, en voilant celui de la bonté et de l'amour. C'est donc cela qu'il faut chercher en elle : une magnifique puissance d'aimer Notre-Seigneur et de le servir dans la joie comme dans la peine, dans la consolation comme dans la persécution. Sur ce point, nous sommes certains que l'abbé Brémond lui-même, qui a quelque peu malmené notre héroïne, est pleinement de notre avis. Et, à notre tour, nous souscrivons aux lignes dans lesquelles il constate, comme nous que ses Écrits n'apportent rien de nouveau à la connaissance de nos dogmes :
«Ce n'est pas là, dit-il, dans ma pensée, un reproche et bien au contraire. Revu, réalisé par un aigle ou par une colombe, le déjà-vu en ces matières ne nous lassera jamais. Loin de nous ravir, le vraiment nouveau nous séduirait peu et nous laisserait sceptiques, nous qui savons que le dernier des évangélistes n'a légué à personne sa plume inspirée, la clef d'or du livre aux sept sceaux. Tout à été dit et Jeanne est venue trop tard...»
Fort bien. Aussi n'attendons-nous de Jeanne aucune révélation nouvelle. Et nous nous étonnons qu'on ait pu l'accuser de s'élever au-dessus de sa condition, dans l'Eglise, alors qu'elle a si bien précisé son désir dans cette phrase d'une lettre au P. Jacquinot :
«Jamais mon intention a été d'être savante, ni le sera, mais bien d'être amante, voire par-dessus tous les saints, si faire se peut selon le divin vouloir. »
Être amante, c'est donc toute son ambition. Et elle s'abandonne pour cela docilement à l'action divine en elle. Elle sait, comme François de Sales, que «la mesure d'aimer est d'aimer sans mesure». Elle montera donc jusqu'au point où Dieu voudra bien la porter, «voire au-dessus de tous les saints, si faire se peut selon le divin vouloir». Si c'est là de l'orgueil, il faut en souhaiter un semblable à tous les chrétiens dignes de ce nom !
En un siècle où les Écritures, hélas! sont devenues un livre fermé à un trop grand nombre de fidèles, où les hautes spéculations théologiques sont tenues pour des ascensions périlleuses, auxquelles les simples fidèles et les religieuses elles-mêmes sont foncièrement inaptes, mais où cependant le goût de la liturgie paraît refleurir en des cercles de plus en plus larges, il semble qu'il serait du plus haut intérêt de montrer en Jeanne de Matel, l'admirable union de l'observation quotidienne de la liturgie missel et vespérale et de la contemplation, à base biblique et à élévation métaphysique.
Enfin, Jeanne serait un bel exemple de ferveur pour la communion fréquente, si décriée par les jansénistes en son siècle, de vaillance dans la lutte contre tous ceux qui cherchent à détourner l'âme affamée de son divin Saveur, et aussi de haute piété mariale. Sa vie la fait connaître en effet sous ce double aspect d'une intelligence profonde de l'Amour divin, en tant que manifesté dans l'Incarnation, puis dans l'Eucharistie, et appelant tous les hommes à un amour de réciprocité, -et d'une institution exquise de tout ce qui exige le titre unique de Mère de Dieu, notamment l'incompatibilité que ce titre comporte avec le péché originel. Ainsi, sous tous les rapports où nous la considérons, Jeanne nous apparaît comme une admirable initiatrice : amour du pape, sens profond et exact de l'accord entre la grâce et la liberté humaine, -communion quotidienne-, culte de Marie Immaculée,- dévotion aux saints,- union constante à la vie de l'Église, dans sa liturgie, dans le dépôt biblique de la révélation et dans l'enseignement théologique. Il n'y a donc que des grandes et belles leçons à recevoir d'elle, pour l'esprit comme pour le cœur !
![]()